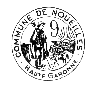| Cette silhouette qui
court sur le chemin de halage, pas de doute, il l’a déjà vue quelque
part. Du moins, c’est ce que pense ton voisin, le jeune homme
accroupi dans la boue comme toi, c’est ce qu’il te chuchote dans le
cou à voix basse. Le cœur battant, tu le regardes plisser ses yeux
d’or et de jais qui scrutent la brume de l’aube et tu t’aplatis un
peu plus derrière les roseaux. Tu appuies ta main sur ta bouche,
parce que tu as peur de crier sans t’en rendre compte. La tête te
tourne, tu t’es penchée trop vite. Le gaillard rougeaud qui ne court
plus, essoufflé, mais trotte sans conviction, arrive maintenant à
votre hauteur. Tu le sais au claquement inégal de ses galoches. Même
si tu n’avais pas baissé la tête sous les griffes d’aubépines qui te
déchirent la nuque, tu ne pourrais distinguer son visage, à cause du
voile rouge qui vacille devant tes yeux.
"Non, je ne sais pas qui c’est. En
tout cas, ce n’est pas Firmin", murmure à côté de toi la voix déçue
de ton compagnon quand l’autre vous a dépassés, son béret à la main.
Il s’en sert pour s’éventer, il n’ira pas loin. Et s’il s’arrêtait
net ? Se retournait ? Tu mets à ton compagnon un coup de coude dans
les côtes. L’autre pourrait encore vous entendre. Il y a dans ta
propre poitrine un tel vacarme que tu ne comprends pas comment ces
pistons de moissonneuse-batteuse qui cognent en toi peuvent être
inaudibles pour l’homme qui passe et ne se retourne pas. "Peut-être
que Firmin ne viendra pas, finalement", chuchote la voix désespérée
de ton voisin.
Du canal monte une brume d’automne
dont l’humidité s’enroule autour de tes mollets nus. Il n’y a plus
de bas depuis bien longtemps, et tes cuisses frissonnent depuis
trois hivers de guerre sous cette jupe trop mince, tes pieds sont
gelés dans ces chaussettes basses de petite fille qui aurait grandi
trop vite.
Tu fermes les yeux, soixante ans
après, et c’est cette scène au bord du canal, qui revient toujours,
encore et encore. Le pont de briques à l’élégante cambrure
dix-huitième, gracieux malgré le badigeon de crépi qui recouvre la
brique. Les roseaux, ou les joncs, des tiges brunes hautes sur
pattes en tout cas, aux épis grumeleux, tout noirs. Des galoches de
bois qui claudiquent, accélèrent, traînent de nouveau. Et le froid,
le froid de l’aube. Le froid qui suinte de la dernière étoile, qui
paralyse cette fin de nuit blanche. Le froid, oui, mais tu pourrais
aussi bien dire la peur. Cette glace tout au long des veines, ce gel
du souffle et du cœur, tu les as longtemps associés à la guerre. A
présent que tu es vieille, tu les sais simplement frères ou hérauts
de la mort.
Tu fermes les yeux, soixante ans
après, et c’est cette image, toujours, qui te revient. La brume
monte de l’eau boueuse et s’enroule autour de tes chevilles. Le
grésil s’accroche à ta frange, condense sur tes cils. Deux parois
transparentes mais hermétiques. Si ténues, et seules capables
pourtant de tenir à distance la peur et la mémoire. L’aube se lève,
humide, glaciale. L’aube d’une nuit que tu refuseras toujours, en
souvenir ou dans tes rêves, de revivre autrement qu’en te voyant
comme une autre, en parlant de toi à la troisième personne.
°°°°°°°°°°°°°
Elle lui ouvre la porte, et recule
aussitôt, dans la protection de l’ombre portée par le battant. Il
n’est pas plus tôt dans le couloir où tournoient les mouches et des
particules de poussière agitées par le dernier soleil qu’il arrache
son béret d’un geste vif. Elle voit ses yeux. Des yeux liquides, en
fusion, noir et or, on ne peut pas faire autrement que d’y plonger,
mais elle sait que c’est une erreur. Il la regarde, il regarde ses
cheveux, et elle porte une main à sa tête, gênée. La teinture
marron, si laide, c’est aussi une erreur. Mais il n’y avait plus le
choix chez le droguiste, lui a dit l’homme revêche qui lui a donné
le flacon et l’a poussée dans une salle d’eau minuscule deux heures
avant le départ du train pour Toulouse.
Il a tiré un vieux portefeuille de sa
poche intérieure, il sort un cliché. C’est elle, en communiante,
engluée dans de la mousseline qui s’est jaunie avec la photo. Il les
regarde, la gamine noyée dans la gaze et elle, alternativement, avec
l’intensité provocante de ces yeux jaunes et noirs qu’elle voudrait
éviter, et elle tourne la tête, hautaine. De profil, il verra bien
ce qu’il cherche. Le nez busqué, le front bombé. Elle est juive,
comment l’ignorer, elle est rousse aux yeux verts, même avec toute
la teinture marron du monde sur la tête, malgré baptême et
communion.
Les yeux parlent, maintenant.
"Bonjour, mademoiselle Odette. Moi, c’est Julien." Il lui tend une
main qu’elle touche à peine. Elle voudrait lui dire qu’il ne devrait
pas conserver la photo, pas de documents, leur a-t-on répété, ne
rien savoir de l’autre. Elle voudrait lui dire que ces prénoms sont
si faux qu’ils ne les emploieront jamais, pourquoi les prononcer ?
Mais au moment où elle ouvre la bouche, toujours en la fixant de ce
regard en fusion qu’elle ne peut plus soutenir, il déchire la photo
en quatre, et puis en huit, et lentement, toujours en la regardant,
il en porte les morceaux à la bouche, l’un après l’autre, et il
avale chaque carré de papier glacé avec lenteur, les yeux mi-clos
quand il les avale, sans les mâcher, avec recueillement, avec
ferveur.
C’est là qu’elle a commencé à
frissonner, pense-t-elle. Dans le couloir, à le voir la dévorer en
communiante. Son ventre s’est tordu en huit, une sensation qu’elle
connaît mais qu’elle refuse. Elle a tourné les talons, sèchement.
Après tout, ce petit campagnard aux yeux fous, à l’accent sonore, à
l’haleine qu’elle parie chargée d’ail, c’est son passeur, pas plus.
Qu’il sache la mener jusque dans les Pyrénées et il peut bien manger
sa photo.
Elle ne lui parle pas, le soir, ni en
lui servant sa part des provisions sur une moitié du papier gras, ni
en écoutant les précisions sèches qu’il lui donne sur leur voyage.
C’est en silence qu’ils calfeutrent la fenêtre pour le couvre-feu.
Puis elle lui montre les deux couvertures pliées sur le banc dans
l’entrée. Qu’il s’en arrange. Elle a installé pour elle le vieux
duvet de son père dans la cuisine, sur un carton. Elle hoche la tête
devant son bonsoir.
Quand les motos sont arrivées, il a
été la trouver d’un bond dans la cuisine, souple comme un chat. Lui
non plus ne dormait pas, alors ? Les motos ne sont pas là par
hasard, sur ce chemin perdu, en pleine nuit, c’est impossible. Ils
sont découverts. Ils sont même perdus, tous les deux le savent à la
panique qui leur fait rassembler leurs pauvres affaires en un
tournemain. Hier soir, ils ont déjà fait les sacs, nettoyé derrière
eux scrupuleusement. Il y a une sortie par derrière, mais quand ils
ouvrent la porte basse, le perron est faiblement éclairé par les
phares d’une voiture dont la carrosserie se découpe au loin, dans le
faisceau de lumière d’autres phares. La maison est cernée, déjà.
Il lui chuchote dans le cou de venir
en empoignant les deux sacs d’une main ferme. Elle le suit, portant
leurs chaussures, en essayant de ne pas buter sur les angles de murs
incongrus, dans cette maison ancienne, presque vide de mobilier,
mais si étrange qu’on se heurte partout et qu’elle n’a même pas osé
visiter hier en l’attendant. Il l’entraîne au fond d’un couloir, il
a son idée, espère-t-elle, une fenêtre qui donne sur une cour
cachée, sans doute, sinon, pourquoi ? Il la pousse dans une chambre
immense, vide à part une armoire paysanne, saillie énorme devant le
mur. Elle le regarde à la lueur de la pile flageolante enlever son
gilet de laine, le glisser sous un des pieds de l’armoire,
s’arc-bouter, la mettre de biais. Il la pousse dans l’espace dégagé,
stupéfaite, et elle se rend compte que l’armoire n’est pas plaquée
contre une cloison, il y a un renfoncement derrière, une sorte
d’alcôve, surélevée de la hauteur d’une marche. Il la rejoint,
glisse un pan de laine sous l’autre pied de l’armoire, puis
s’agrippe à quelque chose, une corde fixée à l’arrière du meuble,
devine-t-elle. Elle s’agrippe elle aussi, l’aide à reculer l’armoire
vers eux, à la plaquer au ras du renfoncement, elle n’a plus le
choix, mais elle est folle de colère. On entend des voix, des
menaces, des coups à la porte. Son cœur remplit l’alcôve de
battements fous, quelle protection espérer de cette cachette
dérisoire, la porte d’entrée va céder, ils fouilleront la maison,
ils auront fait du petit bois de l’armoire en un tournemain, les
chiens les dépisteront. Elle est déjà morte. Elle hait ce compagnon
d’une nuit, celui qui devait être son passeur vers la liberté et qui
ne l’accompagnera qu’à la mort.
Elle le hait, infiniment.
Il pue. Il ne pue pas que la sueur,
la malchance et la mort. Cette odeur, elle la partage, sans doute.
Il pue et elle suffoque, c’est une odeur incompréhensible et
écoeurante, une odeur incroyable, inadmissible, quelque chose
qu’elle n’a jamais rencontrée. Jamais ? Pourtant, il y a
longtemps... Un jour qu’un gamin a raté le tournant sur son vélo,
est allé renverser la poubelle de l’école et valdinguer tête la
première dans la ferraille. Du milieu des légumes écrasés, des
restes de viande pourris a jailli une mince forme noire, qui s’est
ruée sur les enfants accourus au bruit puis a disparu dans le
caniveau en un éclair. Et un grand a dit, - elle le revoit avec sa
blouse grise, ses mollets de coq de combat, c’était Marcel, de la
classe du Certificat -, un grand a crié, en se penchant sur les
détritus, les os dévorés de vermine, en désignant une autre forme
noire, immobile celle-là : "Bon sang, mais ça pue le rat crevé !"
Au-delà des relents de poussière et
de moisi, l’alcôve étouffante pue donc le rat crevé. Elle l’assène à
son compagnon avec hargne. Perdus pour perdus, sur le point d’être
faits, comme des rats, justement, coincés qu’ils sont dans ce trou
derrière une armoire sans style, à deux doigts de leur mort, autant
qu’il entende sa rage. Elle lui jette, plus fort maintenant, puisque
la porte enfoncée qui s’abat sur les dalles de l’entrée couvre de
son vacarme l’invective: "Bon sang, mais vous puez le rat crevé !"
Il ne répond pas. Au vacarme a
succédé un grand silence. Quand le fracas des meubles retournés
signale une fouille méthodiquement rageuse, il se serre contre elle
et elle frémit, se détourne, de terreur, de dégoût, d’autre chose
peut-être, comment savoir, son ventre n’est plus qu’une boule de feu
de toute façon. Alors il lui souffle dans la nuque, d’une haleine
chaude sans la moindre trace d’ail finalement, - ou bien est-ce la
puanteur qui couvre tout ? - : "C’est normal, j’en ai mis deux dans
l’armoire. Deux beaux rats bien crevés."
Il ajoute dans un rire étouffé,
impavide, inconscient, provocateur, comment savoir : "On verra bien
ce qu’en pensent les chiens."
Les occupants sont partis un peu
avant l’aube. En laissant derrière eux l’empreinte de leurs cris, de
leurs aboiements, de leurs insultes. Tout l’apparat habituel des
vainqueurs. Les chiens sont venus dans la chambre, ont gémi devant
les cadavres de rat au fond de l’armoire, jusqu’à ce que leurs
maîtres, l’estomac retourné, les emmènent de force.
Il y avait eu des coups et des
pleurs. Ce sont les sanglots de l’homme qui demandait merci qui ont
été le plus difficile à supporter. Qui battait-on ? Qui suppliait ?
Un ami qui avait trahi, qui sauvait sa vie ? Quel ennemi perdait la
sienne, d’avoir déçu et fourvoyé les maîtres qu’il s’était choisis
et dont la fureur se retournait contre lui ?
Quand l’homme n’a plus rien dit, un
grand silence est descendu tout à coup sur la nuit comme un drap
mouillé. C’est à ce moment-là qu’elle a vomi.
Peu avant l’aube, les phares des
motos qui démarraient ont ébloui la fenêtre sans rideaux, et un
éclair a pénétré par l’interstice de l’alcôve. Cela faisait un
moment qu’elle somnolait, après s’être évanouie, à moitié assise
dans l’espace étroit, la tête posée sur l’épaule du garçon, qui
caressait les boucles soyeuses. Des boucles de rousse, rêvait-il.
Elle le lui avait dit, avant qu’ils ne fouillent la pièce. Elle ne
voulait pas mourir sans qu’il le sache, elle ne voulait pas que son
compagnon de mort la croie née avec ce cirage sur la tête.
°°°°°°°°°°°°°
Et puis, rappelle-toi, - cela, tu
peux te le rappeler -, il t’a sortie de l’alcôve après avoir fait
glissé seul le meuble monstrueux, arc-bouté sur son front et ses
genoux. Il t’a portée-traînée jusqu’à la fenêtre. Aucune force au
monde n’aurait pu vous faire passer par la porte défoncée. Vous avez
filé sous le roncier, vous déchirant les bras, laissant des mèches
en otage aux épines, sans oser souffler, au cas où ils auraient
laissé des gardes devant la maison. Vous avez dévalé la pente, suivi
le sentier creux, et vous êtes arrivés sur le talus qui domine, à
cet endroit-là, le sentier de halage. Vous avez glissé sur vos
talons jusqu’au bouquet de roseaux, et vous avez attendu Firmin.
Longtemps. Dans le brouillard qui s’enroulait le long de tes
chevilles, qui s’insinuait entre tes cuisses serrées, qui faisait
tousser le garçon aux yeux fous. Et, à chaque passant qui venait
vers vous sur le chemin de halage, le cœur vous battait à en mourir.
Firmin n’est jamais venu. Tu n’es pas
passée en Espagne.
Tu es là pourtant, très vieille, bien
vivante. Dans la cuisine, l’homme qui vient de rapporter le journal
et le pain comme tous les jours depuis soixante ans, t’appelle à
mi-voix. L’homme qui t’a jadis confiée à sa mère, une petite femme
timide qui t’a cachée et sauvée sans mot dire, cet homme te tend une
lettre de votre petit-fils en levant vers toi ses yeux de braise.
Des yeux d’or fondu pailleté de jais, des yeux flamboyants d’étoile.
Ils n’ont pas changé. Et comme tous les matins depuis soixante ans,
tu les regardes, tu leur souris.
Texte de Magali Duru, Belberaud (31),
2004
|