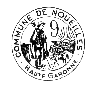| Trente
minutes de retard ! Le froid était terrible. Il releva son col.
Le signal de l’attaque avait été annoncé pour cinq heures trente,
soit juste avant l’aube, au moment où le thermomètre est au plus
bas, et où la fraîcheur contraint les sentinelles d’en face à
relâcher leur attention en se blottissant le nez dans leur capote.
Leur corps y exhale une chaleur le plus souvent puante mais
suffisamment douce pour achever de clore leurs paupières, qui
obturent des yeux bouffis de fatigue. Tous les états-majors de
toutes les armées du monde emploient ce fondement de la stratégie
basique : galvaniser ses propres troupes pour les tenir bien
éveillées et vigilantes jusqu’avant l’aurore, en misant sur
l’assoupissement et l’engourdissement du camp adverse.
Et Louis, notre caporal, de se rendre
compte à sa montre-gousset qu’il est déjà six heures. Dans quelques
minutes, là-bas vers l’est, du côté des tranchées ennemies, l’arrière-ligne
de l’horizon va commencer à se teindre d’un trait de lumière,
bientôt suivi d’un arc de cercle rougeâtre qui commencera à éclairer
les trois cents petits mètres de terrain dévasté qui séparent les
tranchées de première ligne des deux camps. Comme avertis par un
sixième sens, les sentinelles sortent toujours de leur douce torpeur
juste avant les premiers rais matinaux, de crainte que leur légère
somnolence, militairement criminelle, ne les amène à être traduits
devant les tribunaux militaires par les officiers qui les
surprendraient... Et en temps de guerre, les pelotons d’exécution
font foison…
Maintenant, Louis en est sûr : si,
dans les cinq minutes, l’ordre d’attaque n’est pas donné, les
sentinelles adverses seront vigilantes et la boucherie sera encore
plus sanglante que d’habitude ; il sera trop tard, il n’y aura plus
d’effet de surprise, si surprise il peut encore y avoir...
En effet, pense-t-il, pendant une
partie de la nuit, notre artillerie a pilonné l’étroit no man’s land
séparant les deux camps pour le débarrasser au maximum des rangées
successives de fils barbelés destinés à freiner une attaque adverse
(de quelque côté qu’elle vienne, au demeurant...). Nos Poilus ont
beau avoir été conditionnés à penser que les Teutons d’en face sont
des arriérés mentaux, ils ne sont pas débiles au point de ne pas se
rendre compte, ne serait-ce que par expérience, que les
bombardements nocturnes sont annonciateurs d’une attaque à l’aurore.
Louis y a pensé, mais qui d’autre que
lui s’est fait la réflexion? Très peu de monde... Son régiment a été
décimé depuis des mois par de vaines attaques et contre-attaques qui
n’ont eu pour effet que de déplacer la ligne de front de quelques
kilomètres vers l’avant, puis de quelques kilomètres vers l’arrière.
Si encore il s’agissait d’une procession d’Echternach*, le gain de
terrain pourrait être conséquent au bout d’un moment… Mais non, même
pas, la ligne de front a très peu évolué, demeurant quasiment figée
depuis le début de la guerre...
Des cent soixante-huit hommes qui
constituaient initialement la compagnie de Louis, seuls quatre ont
échappé à la mort ou aux blessures graves lors de la dernière et
vaine attaque. Quatre anciens... Pour héroïsme sur le champ de
bataille et citation à l’ordre du jour du régiment, un caporal a été
promu sergent et les trois autres rescapés ont été commissionnés
caporaux. Le reste de la compagnie a été reconstitué par de jeunes
"bleus" issus d’un régiment de réserve, qui avaient connu une
formation militaire accélérée, tous âgés de 18 à 20 ans, sans aucune
idée de ce que peut être mortelle la sortie de la tranchée. Le
nouveau lieutenant est à peine plus âgé qu’eux. Il est frais promu
d’une formation accélérée en académie militaire, où son instruction
a surtout consisté à le persuader que son grade le mettait à l’abri
d’une erreur de jugement, qu’il aurait toujours raison et que la
victoire serait au bout du fusil s’il respectait les ordres d’en
haut. Bref, il était imbu de ses certitudes.
Et le lieutenant était un bon
élément. Le jour précédent, il avait appris du capitaine de
compagnie que sa section avait été sélectionnée pour être à la tête
d’une importante attaque le lendemain à l’aube. Il s'agissait de
tracer la voie pour l’ensemble du régiment qui se tenait quelques
centaines de mètres en arrière. Il avait eu peine à contrôler la
vanité qui l’enflammait. Il avait respecté ce qui lui avait été
enseigné. Lors de la distribution du repas du soir, il avait
harangué la troupe de bleus, le plus souvent quasi incultes, et eux
aussi formés à croire leur supérieur. "Nous avons été choisis..."
; "L’état-major a estimé que c’est à notre compagnie qu’il revenait
de..." ; "Nous aurons l’honneur..." ; "Notre objectif est
primordial..." ; "Le terrain sera dégagé par un pilonnage
nocturne..." ; "Nous les surprendrons avant le lever du jour..." ;
"Ils n’auront pas le temps de résister" ; "Un quart d’heure plus
tard, notre drapeau flottera sur les débris ennemis..." ; "Le
quartier général compte sur nous...". S’en étaient suivies
quelques logorrhées patriotiques, qui s’étaient achevées sur la
traditionnelle annonce : "Double ration de gnôle", ponctuée
de hourras et vivats multiples. L’officier savait parler à la troupe
…
Louis et les trois autres "anciens"
n’avaient pipé mot. Leurs regards s’étaient simplement croisés et
avaient avantageusement remplacé tous les discours qu’ils auraient
pu échanger. Maintenant, ils étaient gradés. Ils ne pouvaient plus
informer la troupe des réalités qui allaient se présenter, au risque
d’être désignés comme traîtres à la Patrie, jugés comme tels et
fusillés pour l’exemple. De tels cas avaient été rapportés sur
toutes les lignes de front.
Lorsque le bombardement du no man’s
land avait débuté, alors qu’ils voyaient les yeux novices de leurs
pairs s’illuminer de joie, ils leur avaient quand même rappelé qu’un
obus, même ami, pouvait avoir été mal manufacturé ou mal orienté et
pouvait s’échouer sur leurs propres tranchées. Le lieutenant,
secrètement vexé de n’y avoir pas pensé, avait feint la fierté
d’être assisté de gradés aussi compétents. Il avait transformé en
ordre la suggestion de Louis de se mettre à couvert sous les sapes
renforcées de bois de charpente, creusées dans les tranchées
traversières menant aux secondes lignes, où se tenaient les
régiments de réserve qui leur succéderaient demain après le premier
assaut.
Vers quatre heures du matin, le
déluge d’obus avait cessé. Par le périscope, Louis avait bien
constaté que, comme d'habitude, peu de barbelés avaient été
désagrégés. En fait, il allait falloir zigzaguer parmi les trous
d’obus, gorgés de l’eau des averses du jour précédent. La boue
allait coller aux godillots, alourdissant et ralentissant encore la
marche, alors que la vitesse de progression constituerait l'un des
rares paramètres de survie (hormis la chance) quand les
mitrailleuses d’en face donneraient toute leur puissance de feu.
Et pour ralentir encore ceux qui
n’auraient pas été tués dès après le coup de sifflet commandant
l’assaut, il y avait ces barbelés d’enfer sous lesquels il allait
falloir ramper et donner de la pince coupante pour que ceux de la
seconde vague puissent envisager atteindre l’ennemi. Louis savait,
comme ses trois amis, qu’en leur qualité de première vague, les
espoirs de s’en sortir étaient quasi nuls. Il avait beau avoir des
sympathies anarchistes et se déclarer athée convaincu, il savait
qu’au coup de sifflet, il invoquerait ce Dieu honni, tout en hurlant
comme les autres. Un appel au Tout-Puissant ne saurait faire de
tort…
Aux alentours de minuit, au lieu de
rêver de gloires et de victoires comme les gamins, il avait écrit
une "belle lettre" comme il disait, à celle qui, au village qui les
avait vus naître et s’unir, l’attendait. Surtout depuis sa dernière
permission avec, au plus profond d’elle, dans son ventre, la marque
irréfutable de la fureur de leur amour : cet enfant à venir pour
lequel Louis essayait de se convaincre qu’il allait se battre, afin
qu’il connaisse un monde meilleur et une patrie libre. Même lui,
l’anar, essayait de s’en convaincre, ce n'était pas peu dire !… Il
avait encore été cité en exemple par le lieutenant qui, le voyant
s’appliquer à la plume, s'était remémoré un autre passage de sa
formation : la veille d’un assaut, encourager la troupe à écrire à
sa famille. On peut être imbu de ses certitudes mais néanmoins
oublier les illettrés… Louis et ses trois amis avaient anticipé le
constat de carence. Ils avaient vite repéré ceux qui n’écrivaient
pas, masquant leur incapacité sous la forfanterie ou arguant de
l’absence de famille. Avec l’aide de ceux qui avaient suffisamment
fréquenté l’école pour pouvoir noircir quelques lignes, ils avaient
eu vite fait de veiller à ce que chacun puisse partir au combat en
ayant entretenu ses proches de quelques-uns de ses sentiments. Les
quatre anciens savaient que ce dernier petit mot serait longtemps
conservé comme relique familiale.
Une fois ces courriers achevés, il y
avait bien eu quelques scènes de vague à l’âme, quelques larmes qui
perlaient à la pensée de celles qui, là-bas, au pays… Le lieutenant
n’avait guère fouillé son argumentation pour galvaniser ces
faiblesses naturelles : « Vous êtes des hommes, tout de même ! »…
« Dois-je y aller seul ? » … le tout renforcé de « la Patrie
qui…» et « l’honneur que...».
Le reste de la nuit, Louis l’avait
passé à se taire, à penser à sa courte vie, à se remémorer ce qu’il
avait fait et ce qu’il aurait dû oser faire. A celle qui portait sa
descendance, il savait qu’il avait dit les beaux mots qu’il fallait
mais en avait-il dit assez ? Vivrait-elle longtemps avec son seul
souvenir ? Comment parlerait-elle de lui à leur enfant ? Il se
surprenait à regretter son combat politique, très engagé certes,
mais pas encore assez pour avoir su changer le cours des choses. Il
imaginait la victoire du prolétariat et des utopies du début de
siècle en serait-on là, à patauger dans la boue dans l’attente d’une
mort quasi certaine ? Même lui, le libertaire, avait su être
galvanisé par la défense de la Patrie…
o-O-o
Six heures et dix minutes : une
estafette s’est glissée de l’arrière, porteuse d’un message destiné
au lieutenant. Malgré son obligation morale de paraître flegmatique,
il pâlit et ses jambes vacillent légèrement. Il prend une bonne
respiration pour s’assurer qu’il pourra maîtriser les intonations
vacillantes de ses ordres. « Sous-officiers, caporaux et soldats
: attaque dans cinq minutes. Nous serons couverts par le feu des
sections latérales. Chambrez vos fusils mais ne tirez qu’à bout
quasi touchant. Mission principale : favoriser le travail des
porteurs de pinces coupantes. L’arrière compte sur nous pour ouvrir
la voie ». Un silence glacial plane quelques secondes,
interrompu bientôt par quelques jurons, quelques gémissements, des
pleurs, et même des vivats…
Louis pense maintenant à lui, à sa
peau. Elle est loin, sa bien-aimée… S’il veut vivre encore des
lendemains qui chantent, il doit agir en automate. D’abord, il fait
froid. Il a froid. Il relève son col. Il respire profondément. Il a
l’œil figé sur l’échelle de sortie…
Coup de sifflet du lieutenant qui, de
son revolver, pointe les hommes pour faire accélérer le mouvement et
surtout pour abattre la moindre velléité de révolte ou d’arrêt de la
progression. C’est au tour de Louis. Bien que regardant devant lui,
il croise un instant le visage terrorisé de son officier. Il voit à
ce regard poupon dépassé par l’ampleur du carnage à venir qu’il doit
craindre autant de lui que de ceux d’en face. S’il glisse dans un
trou d’obus, il risque d’être abattu par son chef paniqué, qui
l’assimilerait à un lâche feignant la blessure. Le vacarme est
assourdissant. Les mitrailleuses amies d’abord, qui tirent depuis
les côtés. Les mitrailleuses ennemies ensuite, qui s’en donnent à
cœur joie sur ces cibles à peine mobiles tant elles sont ralenties
par la boue et les inégalités du terrain labouré par les pilonnages
de la nuit.
Regarder droit devant, ne pas tomber
inutilement et provoquer ainsi une réaction disproportionnée du
lieutenant. Au fait, même s’il est sorti le dernier, est-il toujours
vivant, celui-là, n’a-t-il pas été abattu comme ceux que Louis vient
d’apercevoir choir tout autour de lui ? Il s’en fout. Lui d’abord.
Face à lui, deux rangées de barbelés quasi intacts entravent sa
progression. Il a maintenant l’excuse tactique pour se précipiter au
sol. Il sort sa pince coupante de son ceinturon et s’attaque à ces
fils qu’il abhorre mais qui, en même temps, lui octroient quelques
secondes de répit. Lorsqu’on voit et qu’on entend la mort autour de
soi, quelques secondes de survie ont toute leur importance et
procurent même du bonheur.
Louis pourrait prendre plus de temps
pour poser ses gestes et faire ainsi durer sa vie. Mais il a été
élevé à l’école du devoir. Il continue son travail : cisailler,
encore cisailler. Il se fait sourd aux cris de douleur des blessés
déchiquetés. Quand il entraperçoit certaines blessures chez ses
compagnons tombés près de lui, il se dit qu’il vaut mieux être mort
que de sortir de son corps des cris aussi effroyables.
Brutalement, il n’entend plus mugir
les mitrailleuses ennemies. D’un rapide coup d’œil, il remarque que
sa section est à terre : il n’y a plus de cibles mobiles ; il n’y a
plus que des morts, des blessés, ou quelques survivants qui
cisaillent… Le lieutenant, à côté de lui, siffle pour que l’avance
reprenne. Ne suscitant aucune réaction, il siffle encore puis
vocifère des insultes à l’égard des lâches qu’il va abattre …
« Mon lieutenant, ils sont morts,
ils sont blessés, et les vivants coupent. Tenez, prenez la pince du
mort à côté de vous. Si vous vous y mettez aussi, peut-être que ceux
de derrière pourront aller plus loin ». Et de fait, derrière eux
se fait entendre le coup de sifflet de l’officier commandant la
seconde vague. Et c’est reparti : à nouveau les mitrailleuses
ennemies crépitent et, simultanément, Louis et le lieutenant
entendent hurler les nouvelles victimes. A chacun sa mission : ils
ont entrouvert le passage, à la deuxième vague d’essayer de finir le
boulot, sinon ce sera pour la troisième, puis…
Fi de toutes ces considérations. Les
deux rangées de fils sont dégagées. Louis et le lieutenant
reprennent leur progression. La nausée les envahit à la vue et à
l’odeur des corps éviscérés. Déjà l’odeur des cadavres frais est
insupportable, que sera-t-elle dans quelques jours, s’ils ne sont
pas inhumés ?…
Un crépitement supplémentaire venu
d’en face, et le lieutenant tombe, foudroyé par un projectile au
milieu du front. Louis sent son estomac se révulser mais,
prosaïquement, il conclut que c’est une belle mort, sans souffrance,
si belle mort il peut y avoir. C’est un peu celle qu’il se souhaite…
un peu trop peut-être… La destinée l’a désigné… cette fois, c’est
pour lui ! Il sent un choc à la poitrine. Une onde à la fois chaude
et vibrante l’envahit. A l’instant, il sait que c’est fini. Il sent
encore l’onde atteindre ses pieds et sa tête… puis c’est le néant.
o-O-o
Quelques jours plus tard, deux
gendarmes et le Maire de son village viendront avertir sa veuve de
son décès. Ils lui remettront cette dernière lettre dans laquelle il
concluait : « Si je dois mourir, sache que c’est en pensant à toi
et à notre petit ». Son épouse, et son fils né six mois plus
tard, ne pourraient comprendre qu’en réalité la vie l’a quitté si
vite qu’il n’a pas su penser à eux.
Louis est mort en ne s’imaginant pas
que sa femme l’attendrait jusqu’à la fin de sa propre vie, soixante
ans plus tard ; qu’elle prénommerait son fils Louis, en hommage au
père ; qu’elle s’engagerait dès l’armistice dans le combat pacifiste
et anti-militariste au nom du « Plus jamais ça » ; qu’elle
arpenterait plusieurs fois l’an la nécropole nationale où il serait
inhumé sous la mention « Mort pour la France » ; que son nom
figurerait sur un monument au centre de son village ; que son fils
serait, lui aussi, jeune père de famille lorsqu’il serait mobilisé
vingt-cinq ans plus tard pour mourir dans un nouveau conflit entre
les mêmes belligérants ; que son petit-fils périrait en Algérie...
Lui, le militant des libertés, il n’aurait pu imaginer que sa
descendance se fracasserait aux répétitions de l’histoire.
* L’expression "procession
d’Echternach" est passée dans le langage courant, en référence à la
procession dansante d’Echternach (Luxembourg), connue dans le monde
entier pour la très curieuse progression des fidèles : trois pas en
avant, deux pas en arrière !
Texte de Roger Stas, Flémalle
(Belgique), 2005
|